Broder à la Renaissance
Et si vous vous preniez pour un brodeur ou une brodeuse de la Renaissance ? Tita vous propose de plonger dans ce monde fascinant.
À cette époque, les brodeurs professionnels étaient des hommes, tandis que les femmes apprenaient cet art pour s’en servir dans le cadre domestique. On pensait que la broderie était un bon moyen pour elles de lutter contre la tentation de la paresse (un des sept péchés capitaux) et donc de mener une vie vertueuse.
Johann Sibmacher, Schön Neues Modelbuch…, Nuremberg, Caimox, 1597
Pour réaliser leurs œuvres, brodeurs et brodeuses s’appuyaient, comme aujourd’hui, sur des modèles. Jusqu’à la fin du Moyen Age, ces modèles étaient dessinés à la main et se transmettaient au sein des ateliers et des familles. Mais, à la Renaissance, un nouveau medium vient bouleverser ces pratiques : la gravure, dont les techniques principales sont inventées entre 1400 et 1510. Grâce à elles, pour la première fois, les brodeurs peuvent aussi compter sur des modèles inventés par d’autres et qui ont l’avantage d’être imprimés, reproductibles et relativement peu onéreux. Dès lors, les estampes ornementales et figuratives se mettent progressivement à cohabiter avec les modèles dessinés dans les ateliers. Sentant le potentiel commercial de ces gravures, des éditeurs se mettent même à éditer des recueils adaptés aux besoins des brodeurs professionnels et des nobles dames maniant l’aiguille. Le plus ancien livre de ce type connu est paru en Bavière en 1523.
Au cours du XVIe siècle, plus d’une centaine d’autres ouvrages contenant des modèles sont publiés partout en Europe. On en conserve de nombreux exemples, dont certains portent encore des traces de poinçon, d’aiguille ou des annotations ajoutées par ceux qui les ont utilisés.
Johann Sibmacher, Schön Neues Modelbuch…, Nuremberg, Caimox, 1597
À l’intérieur de ces recueils, on trouve des modèles en noir et blanc, parfois mis au carreau pour être plus facilement reportés sur le textile. Plusieurs types de modèles sont proposés : des ornements couvrants (qui visent à recouvrir une surface), des ornements courants (frises, bordures), des alphabets ou de courtes maximes. Ces modèles sont généralement géométriques, mais ils peuvent aussi intégrer des figures humaines ou des animaux.
Johann Schönsperger le Jeune, Ein new Modelbuch…, Zwickau, Johann Schönsperger le Jeune, 1524 – Johann Schönsperger le Jeune, Ein new getruckt model Büchli…, Augsbourg, Johann Schönsperger le Jeune, 1529
A la Renaissance, certains ornements sont particulièrement appréciés, comme les rinceaux feuillagés hérités de l’Antiquité. Les brodeurs intègrent aussi à leur répertoire des ornements orientalisants que l’on appelle « mauresques » (ou « moresques », dérivant de « maure »). Ces ornements, que l’on nomme aujourd’hui arabesques, arrivent via Venise, un grand port commerçant spécialisé dans l’import des artefacts en provenance du Proche-Orient, et font l’objet de publications dès les années 1520.
Giovanni Antonio Tagliente, Opera nuova che insegna alle donne a cusire, a racammare & a disegnar a ciascuno..., Venise, per Giovan Antonio e Fratelli da Sabbio, 1527 – source de gauche et de droite
De Venise, ils se diffusent ensuite dans toute l’Europe. Grâce à un Italien, Francesco de Pellegrino (dit Francisque Pellegrin), ils atteignent ensuite la France. Sa Fleur de la science de pourtraicture et patrons de broderie façon arabicque et ytalique, publiée à Paris en 1530, semble avoir rencontré un grand succès auprès des brodeurs français, mais aussi auprès des relieurs, des émailleurs et des orfèvres, qui s’emparent eux aussi de ces modèles pour embellir les surfaces qu’ils travaillent.
De nombreux recueils ont été numérisés et sont accessibles gratuitement sur internet. Ils sont dans le domaine public et peuvent donc être utilisés sans restriction, en imprimant les pages qui vous intéressent.
Alors, qui se lance ?
Pour aller plus loin :
- De nombreux livres de modèles ont été numérisés sur archive.org
- Deux recueils de Johann Schönsperger le Jeune (1524 et 1529) en haute définition sur le site du Metropolitan Museum
- Le recueil de Tagliente (1527) sur Gallica, le site de la Bibliothèque Nationale de France
- Le recueil de Pellegrino (1530) sur Gallica
- Un recueil de Johann Sibmacher comportant des modèles de broderie, broderie ajourée et tissage (1597) en haute définition sur le site du Metropolitan Museum
Source de l'image qui vous accueille
Toutes les illustrations de cet article sont sous licence CC0 1.0 Universal (Metropolitan Museum of Art), CC BY-NC-SA 4.0 (British Museum) ou sont tombées dans le domaine public selon le droit français (Gallica).
Merci à Tita pour cet article !
Ajouter un commentaire
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.












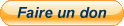
Magnifique et super intéressant. Merci!
Marci, Tita, pour cet article passionnant!
C'est un article très intéressant, et parfois ces motifs sont étonnamment "modernes"
Wahou ! Merci
C'est magnifique!
super article ! c'est du point de croix les premiers ?
Formidable cet article et les ressources proposées à la fin. A garder précieusement !
Article fort intéressant Liseli (et Tita, pardon, la dernière ligne m'avait échappé) , merci !
Super intéressant, merci Tita
Ho merci pour l'article et les ressources 😍. J'ai un vieux recueil de Thérèse de dilmont. Plus récent donc (fin 19e début 20e) et il y a des motifs renaissance. Apparemment il a été réédité plus récemment car je l'ai vu en librairie neuf il y a quelques années.
Il y a eu une merveilleuse exposition à L’Arsenal à Paris en 1995 et 1996 : « Livres en broderie- reliures françaises du Moyen-Age à nos jours » J’ai le livre de l’expo et à la fin, des modèles de Federic de Vinciolo de 1557 permettent de broder ou crocheter ou broder de la dentelle au point coupé avec les carreaux du patron. Très ludique.
Contente que ça vous plaise !
waouh. je mesure mon inculture : qu'est-ce que la broderie au point coupé ?
quel article intéressant! merci beaucoup!
moi non plus je ne brode pas et avoue ma complète inculture sur les points cités. mais ça donne envie de découvrir et de comprendre.
Merci & riche article
Je partage sur Tricotin
@Soffie, la broderie point coupé est de la broderie ajourée à fils coupés, un peu comme le hardanger mais en plus léger, moins de point satin. Tu as aussi la broderie ajourée sans fil coupé, simplement en resserrant le fil, ce qui provoque des trous qu’on peut retrouver à la machine en utilisant une aiguille lancéolée ou Wing mais ce n‘est pas la main.